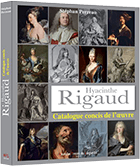La problématique des livres de comptes
La plupart des études contemporaines de l’œuvre de Rigaud sont redevables envers l’existence d’un outil aussi essentiel que complexe : des livres de comptes conservés à la bibliothèque de l’Institut de France sous forme de deux copies manuscrites : les ms. 624 et ms. 625.
On trouve dans le premier manuscrit, la liste année par année des toiles originales dont l’artiste a reçu le paiement, depuis son arrivée à Paris en 1681 jusqu’à sa mort en 1743[1]. Y figurent également les copies majeures qu’il fut amené à réaliser. L’autre cahier manuscrit répertorie les paiements faits aux aides d’atelier pour leur collaboration aux portraits originaux et, de manière non exhaustive on le verra, pour les nombreuses copies et répliques. En 1910, Paul Eudel fut le premier à tenter une simple transcription moderne qui reste peu utile aux historiens car trop fautive. Mais, il est vrai que ces sources, écrites par plusieurs mains successives puis corrigées par Hendrick Van Hulst (1685-1754)[2], ne sont pas d’une lecture facile. À la mort de l'artiste, les volumes manuscrits, lacunaires pour les dernières années de la vie de Rigaud, avaient en effet été confiés à Hulst comme l'atteste l'inscription raportée sur le dos d'un des volumes : « pour remettre à Monsieur Hulst. » La mémoire qui faisait l'attout de Huslt, et la présence, sans doute d'un autre manuscrit perdu (ou de notes de Rigaud), s'était perdue lorsqu'Eudel proposa sa transcription. Peu rompu à la graphie ancienne, il fit une lecture érronée d'un grand nombre de patronymes et ne proposa des identification que pour les plus évidents des modèles.
Neuf ans plus tard, Joseph Roman, correspondant de l’Institut, s’attela à revoir l’ensemble en corrigeant les erreurs de son prédécesseur et, surtout, en proposant des identifications qui firent date. Il s’aida également d’une autre source, aujourd’hui conservée à la bibliothèque de l’École nationale des beaux-arts à Paris, sorte de mise au propre partielle par Van Hulst d’une partie du ms. 624 sous le titre Mémoires des ouvrages de Hyacinthe Rigaud.
Cependant, une relecture nécessaire du matériel original à montré que le chercheur avait souvent mal compris ou mal retranscrit certains noms et expressions, voire même oublié des copies.
Les orthographes phonétiques et autres méprises
D’une manière générale, Joseph Roman eut à faire face aux multiples corrections, ajouts successifs et autres prochronismes opérés sur les manuscrits primitifs. Selon nous, et après un examen attentif des différentes encres, styles d’écriture et surcharges, les deux cahiers de l’Institut furent probablement recopiés de brouillons. En effet, lorsqu’ils furent peints, certains modèles n’avaient pas encore le titre honorifique qu’on leur prêta au gré des pages. Ainsi, bien que titré « cardinal » lorsqu’il passe chez Rigaud en 1709 [*P.1066], Armand-Gaston-Maximilien de Rohan-Soubise ne recevra sa pourpre qu’en 1712. Le jeune prince Frédérick de Danemark, peint en 1691 à l’occasion de son « grand tour » [*P.242], fut qualifié d’« à présent roi » même s’il ne monta sur son trône qu’en 1699. Nombreuses sont aussi les fonctions ou les qualificatifs rajoutés par la suite à un patronyme, le plus souvent pour dissocier un ancien modèle d’un nouveau, ou lorsque le même personnage revenait plusieurs années après dans l’atelier, auréolé d’une nouvelle charge.
À d’autres endroits, la graphie des rajouts avait tout simplement été mal lue par Roman du fait de sa petitesse. C’est le cas, par exemple, de l’aide d’atelier Delaunay qui, en 1705, habilla madame de Tibergaud peinte cette même année [*PC.865] et non monsieur, que Roman avait donc rajouté à la liste des oublis du ms. 624, créant un original qui n’avait pas lieu d’être. Même chose en 1697, quand Antoine Sauvageot, le secrétaire de Rigaud, nota « Mons[ieu]r l’évesque de Montpellier, et le Chevalier son frère et Mad[am]e de Croisy, sa mère. Le fonds du deux ziesme de M[onsieur] Parrocel » [P.502, 503, 504][3]. Roman interpréta correctement l’identité des modèles mais se trompa dans la lecture du mot « deux ziesme » qu’il prit pour « deux derniers ». Cette méprise poussa tous les historiens qui vinrent après lui à croire que Parrocel avait réalisé le fond d’un portrait féminin alors qu’il ne fit que celui du chevalier de Croissy.
Roman fut également influencé par l’idée selon laquelle la clientèle de Rigaud était systématiquement prestigieuse. Aussi puisa-t-il largement ses identifications dans les dictionnaires héraldiques à sa disposition[4], quitte à s’accorder quelques libertés : de là sont nées les fameuses « orthographes contrefaites » des exemplaires de l’Institut. En 1710, le « marquis de Valence » devint sous sa plume un Valancey alors qu’il s’agit d’évidence d’un marquis de Valence d’Angenais [*PC.1101]. De même, si Sauvageot avait pris la peine en 1694 de distinguer deux modèles, le marquis de Senneterre [*PC.375] et le marquis de La Ferté [*P.359], Roman crut à une erreur, fusionna les patronymes et y vit un marquis de Saint-Nectaire. En réalité, on sait aujourd’hui que le rédacteur primitif avait été beaucoup plus précis qu’on ne l’avait pensé, notamment dans les énoncés des titres de noblesse des clients (marquis, duc, comte, chevalier…) ou leur rang au sein d’une même famille (« le père », « le fils », l’oncle », « l’aîné », « sa sœur »…).
Malgré l’absence du tableau lui-même, la plupart des énigmes insurmontables pour l’ouvrage de 1919, ont pourtant été résolues en tenant compte d’une écriture phonétique : le « comte de Rousse » [P.457] s’avéra la prononciation catalane de Ros. L’abbé d’Arle, n’était pas abbé « d’Arlos », mais en réalité Gaillard de Chaudon, abbé d’Arles-sur-le-Tech en Roussillon [*PC.1089]. Certains autres clients de Rigaud résistèrent à Roman à l'instar du curieux « Monsieur de Combebesuze » [sic] qu'il lisait alors dans la liste des portraits peints en 1700. On ne peut en vouloir à Roman d'avoir laissé vierge ce nom car il ne pouvait connaitre les archives provinciales qui révélèrent, il y peu, la véritable identitié de ce magistrat bordelais et avec lequel nous ne fîmes le lien qu'en 2014.
Pour les patronymes étrangers, les nombreuses variations d’une copie à l’autre n’ont pas laissé d’intriguer Roman sans pour autant avoir été décryptées. Ainsi, l’indication d’un portrait du « marquis de Valpo » resta vierge d’identification alors que l’orthographe d’une des copies permettait pourtant d’y voir le conseiller d’État d’un prince palatin en visite à Paris, le baron de Waldpot [*PC.1125]. Même remarque concernant d’Haguin [*P.1227], alias le baron von Haguen, ou encore « milord Moncassel » [*P.316] alias Charles Mac Carthy, comte de Mount-Cashel et enfin « Monsieur Suiny de Londres », alias l’acteur Owen Mac Swiney [*P.1176]… Cependant, les chevaliers Crosse et Tourneur [*P.1406 & 1407], jeunes anglais qui visitèrent Paris en 1736, n’ont pas encore trouvé de correspondance.
Dans le troisième manuscrit de l’École des beaux-arts dont s’était aussi servi Roman, Van Hulst avait systématiquement dissocié les portraits originellement inscrits sous un même prix en divisant avec raison la somme par deux (par exemple dans le cas d’un couple). Mais, pour d’autres effigies dont le prix manquait, Van Hulst proposa une somme par défaut dont le système d’évaluation accusa ses limites et qui mit pourtant Roman en confiance. Ainsi, si le travail effectué en 1695 par l’aide d’atelier Dupré sur une copie à 4 livres d’un original de Monsieur Dellery à 140 livres [*P.392], fit légitimement penser à Van Hulst que les effigies manquantes de messieurs Du Belluy et De Berny devaient forcément avoir semblable valeur, aujourd’hui, l’historien de l’art doit être beaucoup plus prudent. En effet, la réapparition il y a quelques années du portrait du marquis de Flamarens [P.428] dont le prix manquant avait été estimé par Van Hulst puis par Roman à 140 livres s’avère corrrespondre à une effigie valant plus du double !
Le mérite de Joseph Roman fut pourtant grand d’avoir ouvert la voie aux historiens modernes et aux archivistes paléographes qui, aussi aguerris soient-ils dans les sources primaires, ne sont pas à l’abri de tomber, comme nous, dans les multiples chausse-trappes de l’œuvre de Rigaud. Preuve en est, la mention en 1701 d’un « prince de Saxe » qu’une récente publication a confondu avec une possible effigie du roi de Pologne régnant[5]. Pourtant, aucune source n’attestait de la présence à Paris, à ce moment-là, d’un personnage aussi considérable qu’Auguste II « le fort », lequel n’y serait probablement pas passé inaperçu… En réalité, il s’agissait du prince de Saxe-Gotha qui effectuait alors un « grand tour » dans la capitale, et dont le portrait est aujourd’hui conservé depuis l’origine au château de Gotha [P.664].
Si la plupart des modèles de Rigaud sont aisément reconnaissables à leurs titres, leurs fonctions ou leur célébrité, il est plus difficile d’identifier ceux appartenant à des sphères modestes ou peints avant 1680. Nous avons donc préféré rendre à l’anonymat (en italique dans l’intitulé de chaque tableau) les Lefebvre, Charpentier et Desmarest, patronymes trop courants pour lesquels nous ne disposions pas de sources suffisamment fiables[6].
Les doublons
L’un des principaux soucis induits par les multiples corrections des manuscrits fut causé par les doublons, autrement dit la répétition très rapprochée de deux voire trois effigies d’un même modèle et de prix similaires. Ces rajouts eurent deux causes. La première vint du secrétaire de Rigaud qui semble avoir parfois noté la commande d’un tableau (avec ou sans prix) puis, un ou deux ans plus tard, celui du « paiement-livraison » du même. C’est notamment le cas du portrait de Gaspard de Gueidan en habit de président au parlement de Provence [PC.1271] dont la commande est inscrite sans prix, dès 1719, à la suite d’un buste (ms. 624, f° 39 : « Autre Portrait de M[onsieu]r de Guesdan en grand ») ce que corrobore la signature « Fait par Hyacinthe Rigaud en 1719 » au dos de l’original conservé au musée Granet d’Aix-en-Provence. En 1734, les comptes montrent le même intitulé mais avec le prix de 3 000 livres. Le corpus des effigies du parlementaire aixois étant bien connu, il était très improbable que le modèle ait pu se payer deux effigies d’un grand prix, dans un intervalle aussi court. Grâce à la correspondance entre Rigaud et le marquis, on sait expliquer cette bizarrerie : les tergiversations du modèle sur des fleurs de lys, un banc de palais ou une couleur firent en effet traîner en longueur la confection de l’œuvre[7].
D’autres exemples s’avèrent tout aussi éloquents. Ainsi, malgré sa fortune et son statut à la Cour, le marquis de Dangeau aurait-il vraiment pu lâcher sans sourciller, dès 1700, les 650 livres pour un portrait jusqu’aux genoux (ms. 624, f° 18) puis, deux ans après, 600 autres livres correspondant à l’effigie datée et signée « Hyacinthe Rigaud Ft 1702 » que nous connaissons [PC.746] ? Dans ce cas précis, il est vraisemblable de penser que non, le prix de la commande de 1700 correspondant à une estimation, et les 600 livres de 1702 au réajustement lors de l’achèvement du portrait. Remarque similaire pour le fermier général Charles Savalete de Magnanville qui concéda la somme rondelette de 3 000 livres en 1727 [*P.1348], puis, si l’on en croit le rajout de Van Hulst, réitéra l’opération à peine quatre ans plus tard.
La seconde cause des doublons vient des correcteurs, et notamment de Van Hulst dont on voit encore très clairement, dans le ms. 625, le travail de pointage des portraits qu’il jugeait manquants du ms. 624 et qu’il s’évertua à rajouter. À plusieurs endroits, mais pas à tous, il biffa sa correction lorsqu’il s’avisa finalement que l’effigie originale était bien présente, mais simplement notée en décalage par rapport aux travaux correspondant des aides d’atelier. Il est vrai que dans le ms. 625, tous les travaux entre 1702 et 1706 avaient été originellement inscrits par groupes de cinq ou six, sans date précise, et en alternant les noms de leurs auteurs sans raison plus particulière que des probables vagues de paiements[8]. Précédant Van Hulst, une tierce main avait déjà tenté une datation en plaçant, çà et là, une année qui lui semblait correspondre aux originaux du ms. 624. Malheureusement, elle ne prit pas garde au fait que les aides étaient parfois rémunérés plusieurs années après le paiement d’un original ou que ces travaux correspondaient en fait à des copies, produites elles-mêmes beaucoup plus tardivement que l’effigie initiale. Ceci trompa à son tour Van Hulst qui plaça des « originaux oubliés » à une date moyenne de leur confection présumée (laquelle correspondait, à l’inverse, à un travail jugé orphelin dans le ms. 625).
C’est notamment le cas de l’évêque de Laon peint en 1695 [*P.434], dont la mention, ajoutée en fin de liste, fut finalement rayée car l’original était déjà noté deux lignes au-dessus ! De même, l’effigie du duc de Saint-Simon peinte en 1692 [*P.276], se trouva-t-elle ajoutée une seconde fois au début du f°11 du ms. 624. Le biographe de Rigaud, en découvrant que l’aide Leroy avait été rémunéré 6 livres en 1695 « pour une esquisse de M[onsieu]r le duc de S[ain]t Simon », avait en effet pensé à un nouvel original mais, finalement, se ravisa. Au f°21 (1703), trouvait enfin mention des portraits des demoiselles Des Vieux et Mérault [*PC.810 & 811], échos selon Van Hulst, puis Roman, des travaux de Fontaine la même année (ms. 625, f°15). Le portrait de la première était pourtant bien inscrit dans la liste des originaux (ms. 624, f°21 v°), et celui de la seconde rajouté au même folio…
Globalement, la problématique des doublons n’est pas anodine car elle induisit de nombreuses erreurs sur les prétendus « portraits originaux oubliés ». Il fallut donc prendre l’ensemble de ces corrections avec précaution, surtout que nombreuses sont les dates et signatures de l’atelier apposées au dos des toiles qui ne correspondent pas toujours à l’année à laquelle le tableau est mentionné dans les livres de comptes. Nous avons choisi de fusionner les mentions qui nous semblaient redondantes, en prenant le parti d’un seul et unique portrait à la date de la commande ou à celle accréditée par la signature de l’atelier sur l’exemplaire conservé.
Lorsque que nous n’étions pas en accord avec les interprétations de Roman[9] et qu’aucune identité ne nous semblait fiable à proposer, j’ai préféré remettre le nom du modèle entre guillemets, tel que mentionné dans les livres de comptes. Quelques modèles de Rigaud gardent néanmoins encore leur part de mystère. Seule la réapparition de certains tableaux pourra peut-être enfin confirmer l'identité de l’intrigant Monsieur l’armateur ou lever le voile sur les énigmatiques Madame Narcisse et Madame l’inconnue… Enfin, au terme de la relecture des manuscrits, une grande majorité de numéros n’ont pu être reliés à des toiles existantes, ces dernières ayant perdu leur identité au gré des successions, des ventes ou tout simplement des rentoilages. Dans certains cas, et lorsque que nous disposions de sources fiables ou d’une iconographie comparative ou d’un faisceau de présomptions satisfaisant, nous nous sommes tout de même efforcé de procéder à un rapprochement, dans la limite du « vraisemblable ». Nul doute qu’à l’avenir, certains items pourront fusionner, ramenant le total des tableaux du catalogue à un chiffre plus raisonnable.
Par le nombre, la diversité et la constance de ses modèles, par sa propre longévité et sa propension à être acteur de son temps, Hyacinthe Rigaud nous a laissé un matériel d’étude qui semble inépuisable. Notre catalogue raisonné de ses œuvres n’est donc pas un point final mais plutôt une porte ouverte aux nouvelles découvertes.
[1] Un certain nombre d’œuvres autographes aujourd’hui conservées ne sont pourtant pas listées dans les comptes, sans que cela induise un non-paiement du tableau. Il s’agit là d’oublis qui restent assez peu fréquents au regard du nombre total de portraits produits.
[2] Il était conseiller honoraire et historiographe de l’Académie.
[3] Van Hulst raya la mention, la rajouta en 1696 au folio 12 puis se ravisa en rajoutant en marge « en 1697 ».
[4] Les progrès en terme d’études généalogiques ont parfois pu détromper Roman qui ne connaissait pas forcément les dates de naissance et de décès de certains personnages.
[5] Voir le catalogue de l’exposition Dresde ou le Rêve des princes, Dijon, 2001, p. 136.
[6] Même s’il est tentant d’imaginer Rigaud peignant en 1681, le portrait de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), alors jeune musicien de la Comédie Française.
[7] Voir Gibert, 1890. En 1988, à l’occasion de la restauration des tableaux du musée Granet d’Aix-en-Provence, Bruno Ely fit paraître un article fondateur qui servit de base aux études postérieures. Il y mettait pour la première fois en image, les différents changements apportés par Rigaud aux portraits de Gaspard de Gueidan, notamment le travail de Cellony d’après un dessin de Gueidan lui-même et « l’affaire des fleurs de lys »… Grâce à une campagne de radiographies, toutes ces étapes furent révélées en même temps que les sources écrites étaient mises en regard.
[8] Ainsi, l’année 1703 commence au f° 15 et est suivie par 1704 au f° 16. Elle revient au verso du f° 17 avant de céder la place à 1705 au f° 18. Dans cet intervalle on a une alternance suivante qui ne fut pas respectée par Roman dans sa transcription : Fontaine – Fontaine – Leprieur – Leprieur – Delaunay – Bailleul – Bailleul – Fontaine – Fontaine – Bailleul – Delaunay – Bailleul – Leprieur, etc.
[9] Notamment par ce que l’âge du modèle présumé par Roman ne pouvait correspondre à la date du portrait.