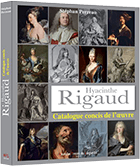Tout en gravissant les marches de l’Académie Royale de peinture et de sculpture dont il devint l’un des profeseurs et directeurs estimé, Rigaud se consacra très tôt, et presque exclusivement à ses clients. Qu’il ait été très tôt dépassé par son succès ou simplement désireux de se ménager, Rigaud fut un artiste qui délégua énormément. Il fut probablement l’un de ceux qui sut le mieux s’entourer de « talents » propres à magnifier son art. Il lança des carrières, fit connaître des noms et puisa régulièrement dans l’académie de Saint-Luc de jeunes peintres en devenir.
L’atelier de Rigaud – dont on peut aujourd’hui dire qu’il fut l’une des plus grandes usines à portrait de la fin du XVIIe et du premier tiers du XVIIIe siècles – vit ainsi assez rapidement le jour, tant notre Catalan remporta très tôt l’adhésion d’une clientèle séduite par son degré d’exigence. Au sein d’une longue et opulente historiographie, Dezallier d’Argenville résuma lui aussi les raisons de ce succès :
« Rigaud sçavoit donner à ses portraits une si parfaite ressemblance, que du plus loin qu’on les apperçevoit, on entroit, pour ainsi dire, en conversation avec les personnes qu’ils représentoient : on peut dire que ces portraits laissoient plus de choses à penser, qu’ils n’en exprimoient ; il s’étoit fait sur la physionnomie des règles si certaines & si bien établies par l’usage, que rarement il manquoit une ressemblance[1]. »
Cette réputation força l’admiration et forgea une clientèle dont l’essentiel était issu des milieux les plus riches (bourgeois, financiers, nobles, industriels, ministres et princes de l’Église), mais aussi de la dynastie des Bourbons, dont Rigaud peignit les effigies sur quatre générations. Si certains continuaient à décrire l’homme comme un « illustre inconnu », embarrassé de « jugements réducteurs et caricaturaux » ou « prisonnier d’a priori historiographiques, volontiers entachés de considérations nationales[2] », il ne faut pas oublier que Rigaud se vantait ostensiblement, de façon récurrente, d’avoir peint tant de modèle illustres. En 1716, lorsqu’il rédigea sa propre biographie à l’attention du grand-duc Cosimo III de Medici, le « peintre des rois » avoua sans vergogne que « les princes, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les ducs, les maréchaux de France, les magistrats et les grands seigneurs qu’il a peints, sont en si grand nombre que le détail qu’on en pourroit faire seroit trop long »…
D’une manière générale, et peut-être davantage que ses contemporains, on sollicitait l’artiste principalement à l’occasion de la négociation d’un événement politique, de la promotion dans un ordre, d’un mariage, de l’obtention d’un titre ou de l’achat d’une charge ou encore à l’occasion de la mutation d’un poste. Tous ces cas se sont avérés éloquents, à l’instar de l’assemblée du clergé de 1705, qui illustra la concentration édifiante dans l’atelier de la rue Neuve-des-Petits-Champs, de certains modèles anciens ou « réguliers »[3]…
Tout comme Nicolas de Largillierre fut qualifié de « peintre de la couleur », Rigaud s’imposa comme le « peintre de la nature », jetant velours et soieries sur un mannequin ou l’un des opulents fauteuils de son appartement, retroussant un brocard, forçant le froissé d’une gaze à la manière d’un décorateur, étudiant la position des doigts grâce à des mains en plâtre « moulées d’après nature » ou reproduisant fidèlement des cuirasses « battues à froid » dont il possédait une panoplie entière[4]. Cette étude fit également dire à Dezallier d’Argenville :
« Rigaud pouvoit être nommé le peintre de la nature, il ne peignoit rien que d’après elle : sans la copier servilement & telle qu’elle se présentoit à lui ; il en faisoit un choix exquis : étoffes, habillemens, jusqu’à une épée, un livre, tout étoit devant ses yeux, & la vérité brilloit dans tout ce qu’il faisoit. […] Les draperies qu’il sçavoit varier de cent manières différentes, & faire paroître d’une seule pièce par l’ingénieuse liaison des plis, faisoient sa principale étude. S’il peignoit du velours, du satin, du taffetas, des fourrures, des dentelles, on y portoit la main pour se détromper ; les perruques, les cheveux si difficiles à peindre, n’étoient qu’un jeu pour lui ; les mains surtout dans ses tableaux sont divines : souvent pour se contenter lui-même, il effaçoit des choses qui l’avoient occupé plusieurs jours, & qui auroient satisfait les goûts des plus difficiles ; le moindre coup de peinceau, un reflet, un passage, un réveillon, n’étoit jamais placé que Rigaud ne pût en rendre compte : extrêmement propre dans ses couleurs, il broyoit les plus belles, & ne négligeoit rien pour en conserver la durée jusqu’à charger lui-même sa palette : ses couleurs en effet & ses teintes sont si vives, que ses premiers ouvrages sont aussi frais que les derniers[5] ».

École française du XVIIIe siècle d'après Balthasar van den Bossche, « l'atelier ». Localisation actuelle inconnue © d.r.
Sans tomber dans l’image d’Épinal, on pouvait ainsi imaginer Rigaud devisant dans son atelier avec ses clients, ses amis graveurs ou collègues peintres, tandis que ses aides s’affairaient à préparer le « crayon » ou l’esquisse de l’attitude choisie. C’est en tout cas cet atmosphère qu’évoque un dessin anonyme, annoté en bas à gauche « Rig.. », que la tradition relayée par le professeur Gallenkamp indentifia comme l’épisode d’une joute entre Rigaud (debout tenant la palette) et Largillierre (accroupi près d’un tableau ovale). Si la scène semble en réalité inspirée d'une œuvre de l'Anversois Balthasar van den Bossche (1681-1715), aujourd'hui conservée au musée de l'Ermitage, ce dessin illustre très parfaitement la commande par un client, à gauche, d’un portrait d’une jeune femme que lui présente un aide d’atelier sous le regard satisfait du peintre. Au fond, un autre aide d'atelier s’affaire à un autre travail… Il n'est ainsi pas déraisonnable d'imaginer que Van den Bossche, qui a travaillé à Paris durant trois ans où son activité est attestée jusqu'en 1700, ait pu assister à une telle séance dans l'atelier de Rigaud déjà célèbre en cette toute fin du XVIIe siècle. D'ailleurs, Bosche, qui œuvrait également pour des collectionneurs et des marchands d'art, semblait avoir été sensible au succès des productions du Catalan puisqu'il reproduisit dans plusieurs de ses propres toiles, le grand portrait du prince de Conti, peint par Rigaud en 1697 ou le buste de Philippe V d'Espagne, peint quant à lui en 1701.
La composition de Bossche, par son thème et sa réthorique, rappelle également une œuvre célèbre de Largillierre, montrant ce dernier dans son atelier en compagnie d’un commanditaire, Thomas-Alexandre Morant, et du graveur Edelinck (Norfolk, the Christler museum of art). À la fois concurrents et collèges à l’Académie royale, Rigaud et Largillierre se considéraient comme des amis, ce qui poussa Dezallier d’Argenville à ajouter :
« On ne peut être plus lié qu’il étoit avec le célèbre Rigaud ; quoiqu’attachés tous deux au même genre, très opposés dans leur manière de peindre, ils ne disputoient entre-eux que de mérite. Largillierre, qui ne voyoit point un rival dans un concurrent, lui dit un jour en admirant ses ouvrages, qu’aucun peintre n’approchoit de lui. Rigaud lui répliqua : “Vous êtes, Monsieur, non-seulement un académicien très distingué ; mais vos divers talens mériteroient six pareilles places”[6]. »

Nicolas de Largillierre, Pierre Drevet dans son atelier. Norfolk, the Christler museum of art
© Paris, documentation des peintures du Louvre
Si Dezallier d’Argenville ajouta qu’à la mort de Rigaud la France avait perdu son Van Dyck, le regard plus critique de Nougaret dans ses Anecdotes des beaux-arts de 1776, apporta quelques nuances aux propos de ses prédécesseurs, soulignant l’aspect plus calculé de la création du Catalan :
« Rigaud est […] comparé à Vandick pour le portrait ; il rendoit […] les étoffes avec un art qui va jusqu’à séduire. On peut néanmoins reprocher à Rigaud que son goût de draper sent trop l’étude. Ses draperies sont jetées avec art, si l’on veut, mais elles laissent appercevoir que tous ces petits plis ou ces cassures que Rigaud croie nécessaires pour l’effet de son tableau, ont été recherchées par le Peintre, & que sans lui ils ne seroient pas où ils sont. Vandick est beaucoup plus naturel. Il rendait la nature comme elle se présentoit à lui, Rigaud comme il l’avoie disposée. Il l’imitoit alors avec scrupule, bien différent en cela de l’Argillière, son contemporain, qui faisoit tout de pratique ou de souvenir. »
[1] Antoine Joseph Dezallier d’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, 1745, t. IV, p. 318.
[2] Catalogue de l’exposition « Rigaud intime », Perpignan, La Célestina, 2009, p. 14, 28.
[3] On y rencontrera les archevêques de Rouen [*P.473], de Paris [*P.491], d’Arles [*PC.901], de Marseille [P.1367], les évêques de Blois [*P.764 & *PC.891], de Saint-Papoul [P.427], de Fréjus [*PC.915], de Montpellier [P.502], de Senez [*PC.900] de Troyes [*P.546] ainsi qu’Augustin de Maupeou, qui lâcha son évêché de Castres pour l’archevêché d’Auch cette même année [*PC.1093]. On remarque à la même époque qu’opposants et partisans à la bulle Unigenitus fréquentèrent et courtisèrent indifféremment le peintre, pourvu qu’il fût en vue.
[4] Tous ces ustensiles étaient d’ailleurs conservés dans une armoire qui revint à sa mort à son filleul Collin de Vermont.
[5] Dezallier d’Argenville, op. cit., p. 319.
[6] Ibid., p. 300.