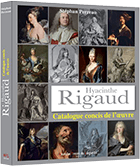Le succès obtenu en France par la peinture de Hyacinthe Rigaud gagna l’Europe entière et perdura longtemps, à tel point que le marché de l’art résonne encore des confusions quotidiennes que l’on peut faire entre un artiste parvenu au plus grand mimétisme et ceux qui le singèrent purement et simplement. Au-delà des frontières du royaume, son nom sonnait en effet autant comme un gage de qualité que comme une accréditation politique, faisant dire à Dezallier d’Argenville que l’artiste « étoit aussi fameux dans les pays étrangers qu’en France ; aucun Milord ne passoit à Paris sans exercer son pinceau ». Il était effectivement courant de retrouver simultanément dans ses livres de comptes et dans les meilleures gazettes à la mode, les noms de princes étrangers en visite en France dans le cadre de leur « grand tour ». Un portrait sorti du pinceau de celui qui avait eu l’honneur de peindre le roi et la famille royale avec tant de régularité, était finalement considéré comme le couronnement de toute mission diplomatique. Aussi les traités de paix drainèrent-ils à Paris un grand nombre de plénipotentiaires européens dont les faces fières alimentèrent les productions de l’atelier dans les années 1698-1705.
Si le littérateur ajouta que l’Allemagne et l’Espagne étaient « remplies de ses ouvrages », on nuancera le propos en constatant que dans la péninsule Ibérique, les témoins de l’art de Rigaud sont finalement assez rares, concentrés aujourd’hui pour leur majorité au musée du Prado ou au Palais royal de Madrid. Par contre, l’Allemagne offre un choix plus large. À l’occasion d’une récente exposition[1], un beau corpus rigaldien a été patiemment recensé, tenant ainsi la dragée haute aux œuvres de Gobert, très diffusées outre-Rhin, ou celles de Vivien. Face à eux, Largillierre ou de Troy font office de parents pauvres. On retrouve dans ces collections la plupart des commanditaires inscrits aux livres de comptes (roi de Pologne, princes et duc de Saxe accompagnés de leurs intendants, jeunes modèles ayant ramené leurs effigies après leur voyage initiatique en Europe…). Également quelques copies protocolaires des Louis XIV, du Grand Dauphin et autre Princesse palatine… un passage obligé en somme. En réalité, l’Allemagne popularisa surtout Rigaud grâce aux pastiches du graveur Johann Martin Bernigeroth (1713-1767) qui n’eut aucun scrupule (à de rares exceptions près) à « coller » des têtes nationales sur des vêtures du Français. Non loin de là, en Hollande, Petrus Schenk singea de la même façon le portrait de Jean de Brunenc, peint par Rigaud en 1687 [P.120] pour confectionner son effigie de Martin Schynvoet.

Giovanni Maria Delle Piane il Mulinaretto. Portrait de Clemente Doria. coll. priv. © photo Poro casa d’Aste
Au-delà des Alpes, l’intégration fut plus brutale car les guerres avaient ramené l’Italie sous le joug français (on se souvient du bombardement de Gènes). La peinture hollandaise, qui représentait l’ancienne obédience, était désormais délaissée, et la péninsule absorba l’art du Catalan, sinon avec fascination, du moins avec condescendance politique. Les postures féminines eurent particulièrement sa faveur et nombreux furent, par exemple, les pastiches du portrait de madame Le Gendre de Villedieu [*PC.709] ou de la duchesse de Mantoue [PC.904] qui ornèrent les palais génois sans que Rigaud ne les vît jamais. Les Pallavicini, Grimaldi et autres Durazzo furent autant de noms à avoir sollicité l’illustre pinceau parisien. Leurs effigies, exposées aux yeux parfois séduits des Italiens, influencèrent durablement les peintres locaux[2]. Spécialiste du peintre italien Giovanni Maria Delle Piane il Mulinaretto (1660-1745), l’historien Daniele Sanguineti illustrait encore très récemment combien cet artiste, à l’instar de Domenico Parodi (1668-1740) et Giovanni Enrico Vaymer (1665–1738), avait su singer de manière confondante les prototypes fixés par le Français. L’exemple le plus frappant est sans doute le portrait de Clemente Doria (1666-1731)[3], dans lequel certains chercheurs français crurent voir l’effigie du « bailly Spinola, de Gênes », peint par Rigaud en 1705 [*PC.882] contre la « modique » somme de 200 livres[4]. En réalité, l’effigie connue du corpus du Mulinaretto avait été littéralement calquée en sens inverse des militaires brandissant un bâton de commandement que le Catalan produisit à la chaîne entre 1689 et 1710…
 Giovanni Maria Delle Piane il Mulinaretto & Giovanni Enrico Vaymer.
Giovanni Maria Delle Piane il Mulinaretto & Giovanni Enrico Vaymer.
Portrait de femme et d'homme. coll. priv. © Finarte Rome
Tout récemment encore, on constatait l’influence du Français dans deux portraits en pendant, typiques de l’art génois des années 1700[5]. L’homme, sans doute de la main de Vaymer, est vu en buste, armé, tourné vers la droite, tendant un bras vers l’extérieur du tableau selon une attitude dont Rigaud fixe le prototype dans ses répertoires d'attitudes cuirassées [P.650 & P.651]. Son épouse, très probablement peinte par le Mulinaretto, est vue de face, le regard mutin, empruntant l’ensemble d’un vocabulaire renvoyant notamment à deux œuvres célèbres de Rigaud en Italie : le portrait de madame de La Ravoye [P.796] et celui de madame Pecoil [*PC.709]. Le ceinturon et sa boucle sont d’ailleurs tout à fait symptomatiques, de même que le traitement des doigts à l’imitation confondante de ceux du Catalan. On peut en voir de similaires dans un Ange de l’Annonciation dont la facture lisse et glacée, renvoie, selon nous, beaucoup plus sûrement au Mulinaretto ou à son aréopage qu’à Rigaud[6]. Le drapé sommaire, le raccourci peu élégant du visage écartent également ce tableau de la perfection habituelle du dessin dont faisait preuve le Catalan.
[1] Voir Rosenberg & Mandrella, 2005, p. 164-171.
[2] Sanguineti, 2000, p. 24-30.
[3] Huile sur toile, H. 149 ; L. 118. Coll. part. (Vte Milan, Poro casa d’Aste, 14 mai 2008, lot. 237). Le tableau fut attribué au Mulinaretto par Sanguineti dès 2001.
[4] James-Sarazin, 2003/2, p. 210-211, fig. 8.
[5] Vente Rome, Finarte, 16 octobre 2007, lots 527a & 527b.
[6]Huile sur toile, H. 57 ; L. 46,5. Vente Paris, Tajan, 19 octobre 2007, lot 76. Ancienne attribution dans le catalogue à Sassoferrato puis à Louis de Boulogne (1654-1733). Pour l’attribution à Rigaud voir James-Sarazin, 2009/2, p. 53 [sans référence à la vente Tajan].